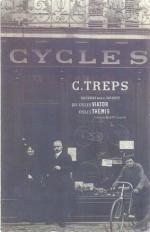Et si je vous racontais Charles Guillaume...
Charles Guillaume, juin 1924
Eh, mon fils ! Viens voir ton père ! Viens me montrer comme je peux être fier de toi ! Tu es grand désormais du haut de tes 16 ans …aussi grand que ton père ! Mais, il va falloir quitter Henriette, et devenir un homme, hein mon garçon !...
- Je vais t’emmener demain faire la tournée de ma clientèle….Tu vas voir le travail de ton père !
|
|
- Oui, Père, je viendrais avec vous.
- Quitter tes livres et les jupes d’Henriette te feront le plus grand bien ! Ton frère est malade en ce moment et il ne pourra pas venir avec nous ! Miamia et Henriette veilleront sur lui ! On partira tôt demain matin pour voir tous les clients que j’ai à visiter !
Charles et Jean sont mes deux garçons ! Je pense que leur mère doit être fière elle aussi, si elle peut les voir de là-haut. Joséphine, mon épouse…son joli minois s’estompe de plus en plus de mes souvenirs, et pourtant je l’ai bien aimée ! Sept ans déjà qu’elle dort au cimetière de la Chartreuse à Bordeaux. Il faudra que j’y amène les enfants d’ailleurs…Mais retrouver cette ambiance feutrée de la mort, parfois c’est au-delà de mes forces moi qui aime tant vivre !...Ah ça, on a bien vécu avec Joséphine !
On s’est connu début 1900….Elle était alors repasseuse et avait déjà une fille : Jeanne, que tous appelaient Henriette…Elle était tout le portrait de sa mère d’ailleurs. Joséphine a eu une sacrée aventure, car après avoir eu une liaison avec un comptable, elle s’est retrouvée enceinte. Il a tout de même reconnu la petite au bout de quelques mois, car pour cet homme, il n’était pas question d’épousailles !
Alors, quand je l’ai connue, vivant dans un sombre appartement du 14 rue Dauzats à Bordeaux avec sa fille, j’aurais été un saligaud de la laisser après notre aventure !
Je l’ai en quelque sorte sortie du ruisseau en lui donnant la chance de créer une famille avec moi, et de quitter le statut de « filles-mères » !
Moi, j’habitais rue de l’Eglise St Seurin avec ma mère et mon beau père. On s’est rencontré dans le tramway électrique : une nouveauté très en vogue dans ce Bordeaux qui commençait le siècle dans la modernité. Utiliser le tramway…c’était tout à la fois une curiosité et une expérience nouvelle!
Moi qui étais un cavalier, cela ne me semblait pas bien respectueux pour les chevaux ! Un cheval est destiné à la monte…. Les voir utiliser pour la traction des omnibus me faisait de la peine …
On s’est connu ainsi car une voiture hippomobile avait tamponnée notre omnibus électrique : du coup, les voyageurs ont du être évacué. Mais, heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Avec l’augmentation du trafic sur les boulevards, les accrochages, sans grands dommages du reste, n’étaient pas rares ! C’est comme ça donc que je l’ai remarquée, la belle Joséphine, avec son sourire coquin, et sa jolie frimousse encadrée de belles boucles brunes…Toute émue et un peu secouée par cette aventure, je l’ai ramenée jusqu’à chez elle … Et puis, ensuite, nous nous sommes revus. D’abord ce fut bien timide, on se voyait quand j’avais du temps, car mon métier m’occupait et les déplacements étaient fréquents. Mais, dans le courant de l’été 1900, alors que nombreux bordelais, sous le poids des grosses chaleurs du mois d’août, avaient déserté la ville pour les bains de la Gironde, je pus prendre quelques jours de repos. En effet, en août le commerce était retombait toujours un peu.

Alors, on était parti avec la petite à Meschers sur Gironde pour une poignée de jours… Mon attirance pour elle est arrivée sans le vouloir, toute seule… avec la mer, le vent, la chaleur, son rire, quelques bains de mer…Ah son rire ! Si cristallin et qui «dégringole» comme un torrent à vous donner le vertige. J’ai succombé…à tout : Elle, la gosse, la vie, l’amour… Je ne pouvais plus imaginer de passer une nuit sans elle, moi le célibataire, j’avais trouvé ma «maitresse » !
On est resté ensemble plusieurs années et ma mère, bien sûr, voulut la connaître.
Je travaillais alors à Roubaix, à l’autre bout de la France, si loin de Bordeaux. Mais, le représentant de commerce que j’étais devait se déplacer, voir les clients et ma société en comptait pas mal dans le nord.
En décembre 1904, quelques jours avant Noël, on a enfin fait notre mariage ! Bah, à 38 ans, j’avais bien profité de ma liberté et puis Joséphine était une sacrée femme. On a fait une noce toute simple. Mes témoins étaient des amis d’enfance: on a tous grandi dans le quartier de l’église Saint Seurin : Camille Lévy employé de commerce comme moi ! On en a fait de drôles d’aventures Lévy et moi ! Plein de principes mon copain juif et le meilleur des hommes: jamais il ne m’a abandonné quand on rentrait un peu éméchés les samedis soirs ! Dire qu’on était voisin, lui vivait rue Nauville et moi, tout à côté rue de l’église St Seurin !
Mon second témoin c’était Albert Fabre commerçant de la rue Judaïque. Plus jeune que moi, c’est surtout son père qui avait veillé sur moi du temps de son vivant, moi qui avait perdu le mien à l’âge de 13 ans !
Quand même, quelle folie, moi qui n’avait jamais voulu passer à l’acte ! Le mariage, je n’en voulais pas, j’aimais trop ma liberté ! Je vivais avec ma mère et ça me convenait bien comme ça… Une sainte femme, Maman Anna, qui a été mon repère dans ma vie d’enfant et d’homme ! Mais, je n’ai jamais cherché à fonder une famille. Pas de frère ni de sœur et mon père est mort jeune et je ne garde pas de souvenirs forts de lui. Ah si, quand même reste gravée une image dans ma mémoire : il n’était pas grand, souvent malade ….Et puis un jour, je ne l’ai plus vu du tout !
Il était ferblantier, mon père et travaillait avec mon grand-père Guillaume, son père.
Enfant, j’ai beaucoup écouté ma grand-mère Jeanne, qui lui vouait une immense admiration…A l’entendre, c’était un homme très grand et imposant: une force de la nature qui menait son monde… Pas toujours facile, le bougre d’après Grand-mère Jeanne. Elle était d’une infinie douceur…Il l’adorait, la Jeanne, sa femme !... Tous l’appelait « Dame Jeanne »…Quelle belle marque de respect
Ce nom la suivait depuis son Cantal natal, notre pays d’origine…Et puis, quelle femme : toujours gaie, et de joie qui brillait dans ses doux yeux bleus ! Elle sentait bon la cannelle, ou plutôt l’odeur de toutes les potions qu’elle mettait sur ses mains et son visage flétri peut-être par les soucis. Dans la même année, en 1879, elle a vu mourir ses 2 plus jeunes fils, puis quelques mois après, son mari ! Et pourtant, même des années plus tard, à chaque fois que je venais la visiter, elle me racontait notre histoire, comme pour qu’elle se grave bien dans ma mémoire, comme pour que personne ne l’oublie après elle !
Quitter le Cantal pour Bordeaux fut tout à la fois, une rupture douloureuse, une déchirure, laissant dernière eux les racines, le pays, les amis, les voisins, le travail… Que de peine… Elle me disait qu’elle avait beaucoup pleuré ce jour-là, car partir sans savoir si elle reverrait un jour sa mère et son père…
A l’époque, on ne voyageait pas ou si rarement, et surtout pour des courts voyages…. Les trains n’existaient pas encore, les liaisons entre la campagne et les villes étaient longues, pénibles, fatigantes et onéreuses. Mais, l’exode, c’était le prix à payer, pour beaucoup de gens de la campagne… le prix à payer pour continuer à vivre, c’est à dire vivre autre chose, dans un ailleurs plus clément et, on l’espérait du moins, rempli de «d’un avenir meilleur» !
Elle et Grand père avaient quitté le Cantal, le pays de la Famille. Saint Santin de Cantalès, Saint Paul des Landes, Nieudan : tous ces noms des communes du pays des parents résonnent aujourd’hui dans ma tête et rien que de les entendre ou de me les remémorer, font monter les larmes dans mon cœur. Cette vie que l’on n’ a pas vécue mais que l’on porte en soit, en héritage. Oui, en héritage car je n’y suis jamais allé … Mais, quel courage pour eux ! Laisser les parents, leurs habitudes de paysans pour l’inconnu des grandes villes. Et pour eux, Bordeaux ! Quelle épopée cela a dû être ! Mes grands-parents ont quitté le Cantal car ils y vivaient mal. Plus d’avenir à la maison, et au milieu du siècle, ils ont quitté Saint Santin et sont partis à Bordeaux avec leurs deux enfants. Leur fils ainé Antoine et mon père Jean qui avaient une dizaine d’années…A Bordeaux, est né Pierre. Mon oncle qui fut maréchal ferrant, lui, est mort la même année que mon père… La même année, et la même maladie ! La phtisie….sale bête qui vient prendre sournoisement les hommes les plus vaillants ! C’est qu’il fallait travailler dur et ne pas avoir peur de l’ouvrage, des tâches lourdes pour les corps et cela par tous les temps, au froid comme au chaud, sous la pluie ou le soleil brûlant… Il fallait être fort et résister au rythme écrasant de la grande ville !
Mon grand-père avait quelques économies, d’après ce que me raconta Grand-mère Jeanne… A Saint Santin, ils avaient vendu les quelques arpents de terre, sa terre, et puis aussi une maisonnette !
En arrivant à Bordeaux, il a tout d’abord été commissionnaire. Grand-mère, quant à elle, faisait des ménages. Ils se sont installés dans un appartement rue Fondandège à Bordeaux. Je les ai toujours connus là… Grand-mère Jeanne est morte 10 ans après mon père, quand j’étais aux manœuvres à Montguyon, pas très loin dans les « Charentes », et je ne suis pas rentré pour l’inhumation…je m’en voulais de l’abandonner, mais l’armée ne permettait pas de revenir chez soi en pleines manœuvres.
Mais tout ça, c’est du passé…. Mes enfants sont là et notre petite entreprise doit croitre pour qu’ils y trouvent une place. Le métier de représentant de commerce est une question de connaissances avant tout mais est aussi faite de rapports humains…Les liens se tissent, les paroles se donnent et les hommes les respectent. Construire un empire pour mes garçons, c’est mon ambition ! Leur laisser une belle place dans la vie, mais il faudra qu’ils se la fassent cette place, en acceptant les bons comme les mauvais côtés du métier. Jean est bien un peu lascif même encore à 18 ans, moins passionné que Charles, et c’est d’ailleurs difficile de le passionner ! il est plus coléreux et Charles, lui, me ressemble, mais il a besoin d’acquérir les finasseries du métier en même temps que les qualités ! Je sens déjà un jeune homme courageux déterminé et qui a de l’ambition !...Mais l’avenir le dira !
Quand pense à ma vie, ce que j’ai construit, je comprends mieux comment tout s’est mis en place et m’a fait tel que je suis là, maintenant.
  |
Je crois que mes plus forts souvenirs se situent à l’âge de mes 18 ans, avec la découverte du vélocipède !
Après la mort de mon père, ma mère et moi vivions rue de la vieille tour au centre de Bordeaux. J’étais déjà employé de commerce chez mon oncle. J’ai découvert ce fabuleux moyen de locomotion en côtoyant les jeunes du vélodrome de Bordeaux. Mais, ce sont surtout les courses qui m’ont permis de me dépasser. Il y en avait sur la route ou sur piste. Je me suis très vite passionné pour les petites courses régionales. On m’a remarqué à Dax surtout. Je les ai tous battus ! Tant et si bien que l’autre champion, Louis Loste m’a même mis au défi pour une course sur la piste d’entrainement du « Vélo Club Bordelais » à Saint Augustin….Ah la canaille, il ne supportait pas que l’on touche à ses prérogatives de champion. Alors, Je me suis entrainé comme un fou. Ma mère me regardait avec frayeur : tous les soirs après le labeur, j’enfourchais mon cycle et ne rentrait qu’à la tombée du jour. Je savais que sur la longueur j’aurais des difficultés. Je me donnais à fond !
Mes copains du club m’accompagnaient et voyaient en moi celui qui allait arriver à faire taire ce champion indélogeable… Mais, ça n’a pas suffi….Il m’a mis au défi, je l’ai relevé, mais je n’étais pas assez prêt ! J’ai perdu….Oui, j’ai perdu. Après cette histoire, on m’a même souvent cherché des noises, en m’accusant de tricher à chaque occasion d’une petite course où je me classais parmi les meilleurs. Les journaux comme le « Véloce - Sport » ont bien dû démentir ces rumeurs. Certes, j’ai des défauts, mais je ne triche pas !
Je montais un « Humber ». Ce modèle était doté, à l’avant une petite roue directrice actionnée par un guidon identique à celui du bicycle et deux grandes roues à l’arrière. Il filait à une bonne allure et ne pesait que 15 kilos: un record à cette époque !...
Un autre gars, Martet m’avait aussi envoyé un défi, non plus sur circuit, mais sur route entre Libourne et Mussidan. Là aussi, j’ai échoué. Bah, cette course s’est déroulée bien après mon entrée au régiment, et là, j’étais vraiment épuisé, trop fatigué pour « la gagne » ; l’entrainement et le régiment, ça n’allait pas ensemble !
Mes débuts militaires auguraient d’une belle carrière… J’étais rentré dans le 15ème régiment des dragons en octobre 1887. C’est un fameux corps qui fut créé par Louis XIV ! Matricule 2620 ! Je m’en souviendrais jusqu’à ma mort !...J’adorais monter à cheval et cet apprentissage ne fut pas compliqué pour moi… Mon oncle maréchal ferrant me faisait souvent monter sur les chevaux quand il les avait ferrés. Je n’avais aucune peur de cet animal et j’ai facilement appris à me tenir dessus !
Je gagnais le grade de brigadier dès 1888, mais hélas, alors que ma carrière semblait acquise, j’ai été blessé en août de la même année, lors de manœuvres à Montguyon. Mon cheval prit peur en allant à l’abreuvoir, fit un écart et me foula le pied. J’écopais d’une fracture du 4ème métatarsien du pied droit.
Après un arrêt de quelques semaines, j’ai réincorporé mon régiment début 1889, où je fus nommé dans l’année « Maréchal des Logis fourrier, » puis « Premier Maréchal des Logis »
l’année suivante. Mais, mon pied ne s’est pas bien remis, et j’ai basculé dans la réserve de l’armée active en 1890 : le métier de militaire se fermait à moi. L’Armée l’a compris et j’ai été réformé en 1899 à cause d’une ankylose du genou droit !
J’ai aussi vite compris que le cycle et les courses étaient finis pour moi…Entre mon âge et mon genou bousillé, ce n’était plus possible !
Mais le cycle demeurait toujours ma passion. Au début des années 90, après la fin du régiment, j’ai tenté ma chance en ouvrant une affaire de cycles, Cours de Tourny à Bordeaux. Mais, j’ai fait faillite. Visionnaire pour l’époque, il n’y avait en fait que moi qui y croyais. J’étais un précurseur, c’était dix ans trop tôt !
Vers 1906, j’ai recommencé l’expérience et ouvert à nouveau un magasin. Maintenant les cycles se vendaient bien ! Joséphine et moi étions bien fiers de notre affaire ! Toujours située Cours de Tourny, la clientèle huppée de Bordeaux s’y pressait. La mode était aux promenades en bicycle. On avait même un commis qui assurait les réparations. Les cycles avaient besoin de réglages, d’entretien et pas grand monde ne savait le faire. Moi j’étais déjà prêt et compétent depuis longtemps !
La vie de famille commençait à me plaire et les enfants sont arrivés en 1906 et 1908…Henriette avait deux frères. Les enfants grandissaient, Henriette du haut de ses douze ans prenait des cours de chants et a eu même, vers ses vingt ans, le privilège de parfois chanter au Grand Théâtre de Bordeaux… Cela a duré jusqu’à la déclaration de la guerre en 1914. Les affaires chutèrent très vite, le commerce ne marchait plus ! Les cycles n’étaient pas la priorité, surtout pour les pauvres gars qui partaient à la guerre. Le pays paraissait en panne. Moi, j’avais de la chance : réformé en 1899, il n’était pas question, qu’à presque 50 ans, je parte au front.

En 1915, Joséphine est « partie » !
Et je me suis retrouvé seul avec mes deux garçons et Henriette. J’ai ramené toute ma famille auprès de ma mère et de son nouveau mari, Papy Henri, comme l’appelaient Jean et Charles. Ça n’a pas duré car l’année suivante c’est Henri qui est allé remplir le caveau familial !...On s’est retrouvé alors avec Maman… Henriette était irréprochable, et manifestait beaucoup d’amour pour ces deux petits sans mère. On avait une bonne qui faisait toutes les emplettes et la cuisine. Malgré tous ces évènements tragiques, je dois dire que nous avons vécu des années douces, juste avant la disparition de ma mère et jusqu' après la guerre…Elle s’est endormie dans un sommeil sans retour un soir de janvier 1919…Ma pauvre Maman, qui a perdu ses deux maris…
Mais je suis satisfait car les enfants et moi sommes restés avec elle jusqu’à la fin…C’est trop sinistre et si désolant de voir ce qui se passe maintenant… Tant et tant d’enfants quittent leurs parents et les laissent vieillir, dépérir, seuls, abandonnés, seuls dans leur souffrances, leurs douleurs dans le froid de la vieillesse .Quelle tristesse !
Après sa mort, nous avons quitté Bordeaux. J’ai fermé le magasin, et vendu tout ce qui pouvait l’être. Ce fut un crève-cœur pour tous. Je me souviens très bien de notre visite au cimetière de la Chartreuse, les enfants, Henriette et moi…Ce fut pire que les visites régulières que nous faisions tous les mois. C’était comme si on les abandonnait comme des inconnus, qui n’auront plus de visite, de pas qui s’arrêteront devant leur dernière demeure.
Qui viendra les voir désormais ? Qui leur rappellera les bons mots, les blagues et les souvenirs heureux que nous avons vécus ensemble ? Qui entretiendra la tombe ? Il a fallu que j’explique aux garçons que leur mère sera vivante tant qu’ils penseront tous les soirs à elle. Même si cela ne change rien pour elle maintenant, au moins les enfants seront un peu moins tristes, enfin je l’espère…
J’eus l’opportunité de monter à la capitale car un emploi de représentant de commerce chez Peugeot s’offrait à moi… La société cherchait un représentant qui connaisse le domaine du cycle à fond. Les garçons devenaient grands et continuaient encore de suivre l’école. Heureusement, Henriette veillaient sur nous tous… J’ai dû, non sans déchirement, vendre la maison de ma mère, et cela nous a aidé pour trouver à nous loger à Paris. Des connaissances parisiennes au sein de la grande famille des professionnels du cycle, m’ont aidé à trouver un appartement et la famille a emménagé en 1920 au 48 Boulevard Raspail.
Le sixième arrondissement n’était pas rupin, mais un «beau» quartier tout de même pour « démarrer » dans la capitale. De plus, pour les garçons, de bons lycées étaient assez proches de notre nid...
Hier matin, on est donc parti Charles et moi. C’était tôt, vers sept heures, et on a pris l’automobile que la société me prêtait : c’était une Peugeot 25CV affublée d’un moteur six cylindres qui sortait de l’usine de Sochaux ! Quelle fierté ! On a donc commencé par passer à la Direction Générale de Peugeot, sur les quais de Passy. Il me fallait vérifier quelques données sur les stocks disponibles de nos cycles : Charles était très surpris de voir que tout le monde, secrétaires et hommes de magasin me connaissaient ! Ensuite, on est parti pour les magasins de cycles parisiens qui faisaient partie de ma clientèle.
J’ai une certaine chance : c’est le printemps, et les ventes vont augmenter. L’entreprise vend quand même 62 000 bicycles par an ! Alors, il faut voir les vendeurs, mais surtout bien les accompagner dans les différents modèles à conseiller à la clientèle. Un client satisfait recommande toujours son magasin et surtout sa marque de bicycles ! Pour les hommes et les dames, ce ne sont pas les mêmes modèles, et pour les sportifs il y a encore d’autres modèles différents.
Lors de mes visites des clients, je montre aussi les toutes nouvelles pièces détachées, les pneus ou les petits accessoires « tout frais » sorti de la production de l’usine… Les magasins ont fleuri dans la capitale, et même derrière la petite couronne !


Depuis les débuts du «Tour de France» en 1903, une vingtaine d’années maintenant, la mode du cycle n’est plus à démontrer. Les parisiens s’en servent pour aller à l’usine, faire leurs courses, se promener et plus simplement pour se déplacer plus vite d’un point à un autre.
Certains les utilisent pour la promenade du dimanche, le long des boulevards et pour rejoindre les bords de Seine.
Charles a eu l’air ravi de sa journée : c’est un passionné et j’en suis ravi. Il à l’âge de travailler maintenant mais j’hésite. Après l’été, soit je le fais rentrer dans l’entreprise, comme commissionnaire, soit je le laisse poursuivre ses études. Je suis encore indécis mais il n’est pas très virulent dans les études et la pratique vaut toutes les théories….Il me faut y réfléchir, et j’ai tout l’été pour cela….Déjà, en juillet, les deux garçons vont rendre de menus services aux magasiniers de l’usine. Ils seront coursiers et cela va les former à ne plus languir sur les bancs du lycée…De la pratique, que diable !...Mais Jean a un caractère trop coléreux et rebelle : l’été dernier il n’avait pas terminé sa besogne…peu diplomate et pas tellement capable de travailler avec d’autres, je crains qu’il ne puisse pas s’adapter au travail à l’usine…
En Août, nous retournerons à Bordeaux, c’est décidé. Nous ne sommes pas retournés sur le caveau depuis deux ans. Nous resterons quelques jours chez les cousins Fouquet qui habitent près de la Gironde. Cette année, je pense que le train nous y mènera car un voyage aussi long en automobile serait trop pénible à supporter, surtout pour les femmes…On part avec Henriette et les garçons. Ah Henriette…. Aurais-je honte de me retrouver devant la tombe de ma femme ? Parce qu’ Henriette et moi avons une histoire depuis quelques mois… On reste discret, c’est ma condition ! Les garçons ne semblent pas s’en rendre compte. Et elle m’adore Henriette… Je me suis senti un peu gêné au début…Mais, qu’est ce qui est le mieux pour mes gars ? Que je leur ramène une belle mère qui ne les aimera pas ? Est-ce une si grosse trahison que de se trouver avec une nouvelle femme dans sa propre maison ? Certes, elle est encore bien jeunette, mais cela n’a pas que des désagréments : Henriette a la trentaine et moi, j’ai le double de son âge… Elle n’a pas le tempérament de sa mère mais a d’autres qualités et aime aussi diriger sa maisonnée. Sa présence est réconfortante, apaisante et me fait du bien, ; du coup, je ne m’occupe plus de la maison, et cela me laisse du temps pour mon métier… Je suis bientôt vieux, mais c’est son choix …Elle n’arrête pas de me dire que je suis «un être d’exception» et que je suis «le grand amour de sa vie» ! Alors, respectons-la et nous pourrons continuer d’être heureux !
Epilogue
Charles Guillaume est mort en 1947 après cette terrible période de la seconde guerre mondiale et la division des amis selon leurs opinions et le camp que chacun avait choisi…Pétain ou De Gaulle…Il vécu rue Massenet, entouré de celle qui fut toujours auprès de lui Henriette, sa maîtresse et son admiratrice, son fils ainé Jean et Miamia, la sœur de Joséphine.
Jean et Charles reprirent les activités de leur père. En 1945, Charles son propre fils, sera jugé pour avoir choisi le camp de la « collaboration » …ce fut une collaboration qui se limitait à un commerce de bicyclettes… Pendant la guerre, il fut ami de bien célèbres collaborateurs : l’écrivain Robert Brazillach, qui fut fusillé après un procès rapide et expéditif en février 1945. Il passera un peu plus de 2 ans en prison à Fresnes. Il y était avec son grand ami Jacques Schweitzer, militant d’extrême droite et Président des Jeunesses Nationales. Lui fut ensuite gracié et les deux hommes ont entretenu une longue amitié après la guerre. Leurs familles se rendaient visite régulièrement, et ils passaient des vacances parfois ensemble…
Charles, son fils préféré, a épousé la belle Anne Marie en 1934…une jolie fille de Brunoy issu d’une ancienne famille noble, qui avait une classe naturelle qui la rendait très séduisante et intemporelle. ..Mais, pendant la guerre, sous le poids et l’influence familiale le couple a vacillé: Charles eut une aventure avec Paulette, une voisine du dessus, et Anne Marie quitta Paris avec son fils Bernard, pour rejoindre Nice où vivait sa mère. Charles divorça après la guerre, se remaria avec Paulette, qui semblait adoubée par Henriette et Charles Guillaume …car elle paraissait plus facile à manipuler dans le sens de leurs intérêts…
Jean, son autre fils, est parti travailler en Allemagne et a adhéré à la doctrine nazie. Il est rentré en France et s’est caché au dernier étage rue Massenet, dans la chambre de bonne…Il n’a jamais été jugé.
Mais Paulette fut une femme douce et déterminée qui a bien réussi à garder son mari, et à vivre une vie bien à part du clan, avec leur fille Anne Marie née en 1942…Par contre, Charles versera une pension toute sa vie à Henriette qui fut tout à la fois sa demi sœur, sa seconde mère et sa pseudo belle-mère ! Charles qui fit sa carrière en qualité de représentant de cycles multi cartes, a toujours rêver de devenir Médecin… Peut-être parce qu’il aurait tant voulu sauver sa mère ! C’est sans doute celui qui a le plus souffert de sa disparition précoce. Celle-ci portait toujours un gros bijou avec une pierre verte et le chiffre « 13 » en porte bonheur. Il ne supportera jamais, ni cette couleur ni le chiffre 13 !
Charles Guillaume et Henriette reposent ensemble dans le caveau familial à Bordeaux
Lors de la mort de Charles, Paulette réussit à le faire exhumer quelques mois après son décès, pour que son corps repose loin du clan TREPS…Mais les tombes sont bien proches et le caveau familial accueille aujourd’hui, dans l’ordre:
TREPS Jean inhumé le 20 juillet 1880 (père de Charles Guillaume)
PICQ Antoine le 6 juillet 1884 (père d’Anna)
FOUQUET Anna veuve TREPS le 23 Novembre 1915 (Joséphine)
GRENIER Henri le 16 octobre 1916 (second époux d’Anne PICQ)
PICQ Anne le 9 Janvier 1919, veuve GRENIER (mère de Charles Guillaume)
TREPS Charles Guillaume le 31 Octobre 1947
CABANNES Jeanne le 10 Juin 1983 (alias Henriette TREPS)





 C'est la mère de mon arrière grand père maternel
C'est la mère de mon arrière grand père maternel















 Adolphe
Adolphe



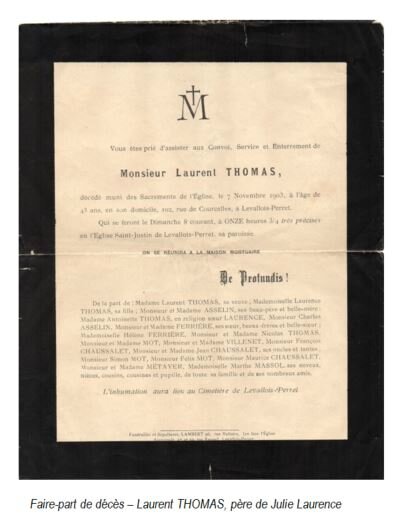










 Leur mariage en 1911 à Levallois Perret
Leur mariage en 1911 à Levallois Perret